Texte n° 2 - novembre 2022
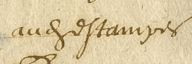
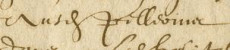
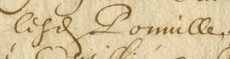
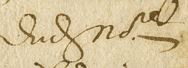
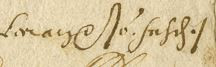
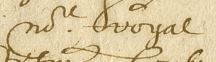
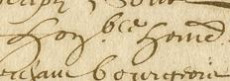
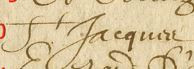

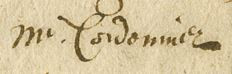


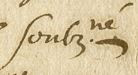
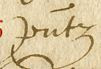
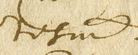
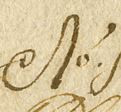
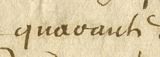
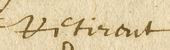
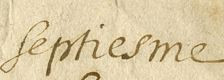
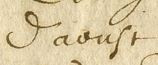
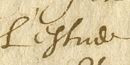
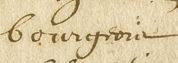
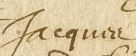
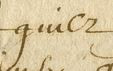
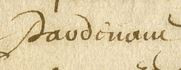
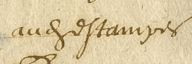
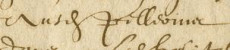
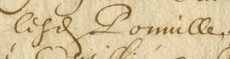
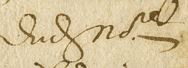
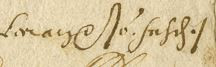
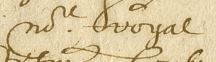
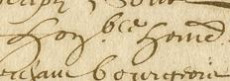
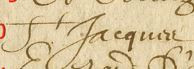

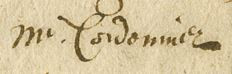


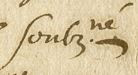
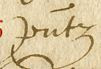
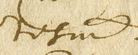
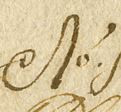
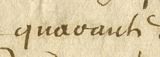
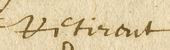
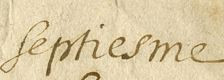
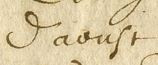
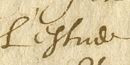
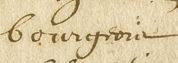
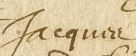
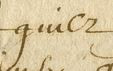
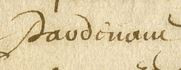
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.